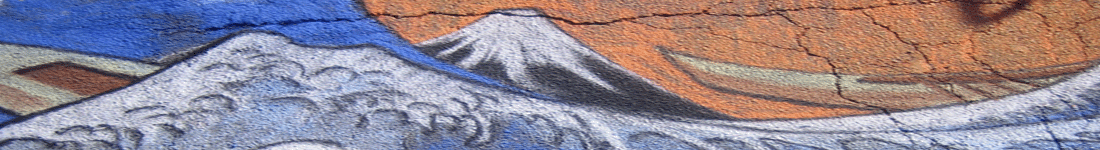Si l'humanité n'était faite que de romanciers, il n'y aurait pas de guerres...
Je n'avais vraiment pas envie d'aller à l'Est. Je n'aime pas la parisienne gare de l'Est. Sinistre. Le retour des hommes défigurés. La gare du Nord, oui, celles de Lyon et de Montparnasse, oui encore. Mais la gare des guerres...
Il aura fallu que ces connaissances liées au sortir d'une conférence déploient une sacrée énergie pour que je foule cette terre lourde entre Laon et Soissons un matin de novembre.
Dans le train, fantôme nu dans le givre, je repensais au très beau livre de Maurice Genevoix, Ceux de 14, lu autour de mes quinze ans. Et j'ai à nouveau entendu sa voix lorsque, dans le parc, Genevoix et l'un de mes aïeuls reparlaient de tout ça qu'ils avaient, côte à côte, vécu de près.
Je pensais aussi à Alain-Fournier, tué dans les premiers jours de septembre 1914. Le Grand Meaulnes...
Le grand vent et le froid, la pluie ou la neige, l’impossibilité où nous étions de mener à bien de longues recherches nous empêchèrent, Meaulnes et moi de reparler du Pays perdu avant la fin de l’hiver. Nous ne pouvions rien commencer de sérieux, durant ces brèves journées de février, ces jeudis sillonnés de bourrasques, qui finissaient régulièrement vers cinq heures par une morne pluie glacée.
Rien ne nous rappelait l’aventure de Meaulnes sinon ce fait étrange que depuis l’après-midi de son retour nous n’avions plus d’amis. Aux récréations, les mêmes jeux qu’autrefois s’organisaient, mais Jasmin ne parlait jamais plus au grand Meaulnes. Le soir, aussitôt la classe balayée, la cour se vidait comme au temps où j’étais seul, et je voyais errer mon compagnon, du jardin au hangar et de la cour à la salle à manger.
Les jeudis matins, chacun de nous installé sur le bureau d’une des deux salles de classe, nous lisions Rousseau et Paul-Louis Courier que nous avions dénichés dans les placards, entre des méthodes d’anglais et des cahiers de musique finement recopiés. L’après-midi, c’était quelque visite qui nous faisait fuir l’appartement ; et nous regagnions l’école... Nous entendions parfois des groupes de grands élèves qui s’arrêtaient un instant, comme par hasard, devant le grand portail, le heurtaient en jouant à des jeux militaires incompréhensibles et puis s’en allaient... Cette triste vie se poursuivit jusqu’à la fin de février. Je commençais à croire que Meaulnes avait tout oublié, lorsqu’une aventure, plus étrange que les autres, vint me prouver que je m’étais trompé et qu’une crise violente se préparait sous la surface morne de cette vie d’hiver.
Ce fut justement un jeudi soir, vers la fin du mois, que la première nouvelle du Domaine étrange, la première vague de cette aventure dont nous ne reparlions pas arriva jusqu’à nous. Nous étions en pleine veillée. Mes grands-parents repartis, restaient seulement avec nous Millie et mon père, qui ne se doutaient nullement de la sourde fâcherie par quoi toute la classe était divisée en deux clans.
Oui, tu l'as dit : jouant à des jeux militaires incompréhensibles... Sauf que tout ça est très compréhensible. Très.
L'endroit aujourd'hui à l'envers : c'est un coin de plateau verdoyant où il fait bon festoyer.
Sublimation.
Conjuration.
(Maurice Genevoix, Ceux de 14, Seuil, 1996 / Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, Le Livre de Poche, 2008)