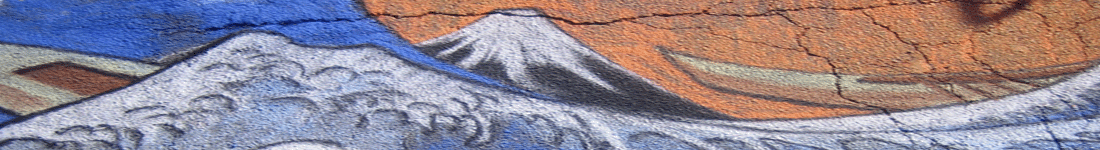Sirocco britonnique.
Lueur du jour. Le train qui vient de traverser l'élégante cité d'Oxford fonce maintenant vers la côte. La locomotive a la volonté manifeste de rivaliser avec la vitesse du vent qui balaie tout sur son passage. J'aurais pu descendre à cet arrêt, car j'aime bien la ville-université où l'on peut encore croiser Duns Scot ou Thomas Stearns Eliot dans les jardins de Merton College. J'y ai de bons souvenirs. Par exemple, du côté de la Bodleian Library. Ou du côté de la Turf Tavern, Bath Place. Ce sera pour une autre fois. J'ai l'intention de séjourner un ou deux jours, trois au plus, dans la petite station balnéaire de Weymouth située dans le Dorset. Pour mener ce projet à bien, il m'a fallu des préparatifs et des changements d'itinéraires. Ce n'est pourtant pas éloigné de mon point de départ, mais ce n'est pas rien et, au fond, cela m'amuse.
La gare, terminus de la South Western Line qui relie Bristol à Londres, a été, me dit la plaque commémorative, entièrement reconstruite dans les années 1980. L'ancien édifice, ne pouvant plus accueillir le flot continu des touristes, méritait sans doute un lifting digne des temps modernes. Je savais que Weymouth avait, depuis belle lurette, un authentique pouvoir d'attraction : John Constable qui est loin d'être un mauvais peintre a souvent arpenté le coin. Ses exquises esquisses, ses croquis sur le vif et ses toiles nous donnent à voir des paysages côtiers plutôt tourmentés en gris et bistres grotesques, au sens premier, qui contrastent avec l'apparente tranquillité du rivage très aménagé d'aujourd'hui.
Mais ce n'est pas tant à Constable que je pense ce matin tandis que je me dirige au gré des rafales vers un café à la devanture bleue pour prendre mes marques. Non, j'ai devant les yeux, mentalement parlant, les premières pages de Weymouth Sands :
The sea lost nothing of the swallowing identity of its great outer mass of waters in the emphatic, individual character of each particular wave...
(La mer ne laissait pas entamer son individualité : de toute l'énorme masse visible de ses eaux, elle restait la mer, entité triomphale, gouffre insatiable en dépit de la fougue que les vagues mettaient à imposer leur caractère individuel...)
Ce roman hyperbolique, mon cher John Cowper Powys l'a écrit à des milliers de kilomètres d'ici, dans l'agitation new-yorkaise. Nous sommes en 1934 et John commence à en avoir assez de son existence outre-Atlantique au point de vouloir revenir, en deux temps trois mouvements, au pays - haut en couleur ! - de Galles. À cause de John, j'avais le désir de voir d'assez près à quoi ressemble Weymouth et ses environs.
Après le café qui avait un goût de thé, l'air redevenu doux aidant, j'ai marché jusqu'au bout de l'Esplanade -The Esplanade, s'il vous plaît. Je suis resté là un moment à regarder la manœuvre de l'unique ferry qui se portait au mouillage. À quelques encablures, plus au Sud, la presqu'île de Portland dans un nuage d'oiseaux. Activités des uns, activités des autres. Rebroussant chemin - je ne pouvais aller plus loin au risque de tomber directement dans l'eau -, je suis passé devant un gîte géorgien de luxe, a guest house, qui porte le titre exact du roman de Powys. J'entre et me fait donner certains renseignements par une dame qui portait non pas une jupe, mais carrément une robe à motifs écossais. L'endroit ne manquait pas de charme, mais je préfère l'hôtel légèrement en retrait où j'ai réservé une chambre. En effet, parcourant un prospectus à la gare avant d'entrer en ville, comme quoi il faut toujours avoir l'oeil actif, j'avais remarqué toutes sortes de festivités qui, d'après le calendrier, devaient se produire au cours de la semaine dans les parages de la guest house, notamment au Game Zone-Laser Zone. Je craignais déjà le pire. Mon choix était donc le bon.
Soir de brume dans ma chambre à l'hôtel.
Je fume un cigare Hamlet. Finalement, ,j'aurais déambulé dans la ville toute la journée et vu tout ce que je voulais y voir, empruntant le dédale de ses rues pittoresques derrière le port : Maiden Street, Market Street, Saint Nicholas et Saint thomas Streets, une East Street mais pas de West Street, une Franchise Street et une belle Helen Street. Chez un libraire-antiquaire - la boutique, matières sur matières, était la convergence en un point focal de tout ce qui a été manufacturé en Angleterre depuis au moins un siècle -, je n'ai pas trouvé le moindre bouquin digne d'intérêt. Ce n'était que de la fiction en tombereaux d'éditions bon marché. Mais, au milieu de ce fatras, j'ai déniché un petit lion de bronze de bon poids que je me suis offert et que je placerai au retour sur les feuillets épars dans l'atelier.
J'avais faim et suis reparti, guidé par le hasard. Dans un restaurant propret tenu par un ancien de la Royal Navy, une assiette de fruits de mer et un honnête vin blanc portugais ont composé mon repas. Après le dîner et un whisky offert par le patron en souvenir du Débarquement, j'étais heureux de mon sort. Malgré le vent qui n'avait pas cessé de souffler depuis l'aube et les bancs de brouillard de plus en plus compacts, je ne voulais pas rentrer tout de suite. Sur le pavé, canettes de bière à la main, des groupes de jeunes tapageurs se dirigeaient vers la zone de jeux. J'oblique vers une rue plongée dans une étrange lumière jaune et verte. Une bonne surprise m'attendait : un cinéma. À l'affiche, The Ghost and Mrs Muir, un de mes films préférés et la séance allait débuter. Good ! Je ne pouvais trouver mieux ! Pendant une heure et demie, le vent dehors, le vent sur l'écran, j'étais tantôt Captain Gregg (magistral Rex Harrison), tantôt Lucy Muir (touchante Gene Tierney). Et je n'oublie pas la jeune Nathalie Wood et le délicat George Sanders. Sait-on qu'ils étaient, l'un et l'autre, d'origine russe ? Le Gull Cottage de Mrs Muir me plaît beaucoup dans son retirement à la fois simple et raffiné. Vu les conditions atmosphériques, les scènes de bourrasques, quant à elles, auraient pu être filmées ici, à Weymouth. Sauf que, si ma mémoire est bonne, elles le furent sur la côte de l'océan Pacifique, au Nord de Carmel, en Californie.
Le lendemain, préparant mon paquetage, la tête encore pleine de gentils fantômes, je me dis, jetant par la fenêtre un dernier coup d'œil à la ligne d'horizon, que je ferai bien de monter en bus vers le Nord, vers le pays de Galles, vers un ailleurs à revisiter...
(Joseph Leo Mankiewicz, The Ghost and Mrs Muir, 1947 / John Cowper Powys, Weymouth Sands, The Overlook Press, 1934, Les Sables de la mer, traduction de Marie Canavaggia, préface de Jean Wahl, Plon, 1959)