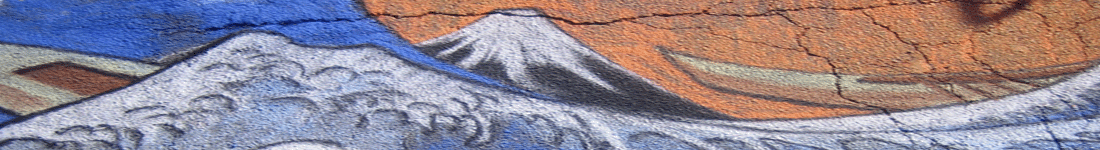Trois jours à déambuler dans les vieux quartiers.
Sur une passerelle, une pseudo-geisha en kimono flashy, sans doute freeter, travailleuse précaire, se fait tirer le portrait par un photographe barbichu. Son image de courtisane à trois sous ira illustrer le calendrier des camionneurs. On a l'estampe qu'on peut. Malgré ses simagrées simiesques, Kiki de Gion, le sobriquet sur chaque cliché, est plus avenante que les rabatteuses rabat-joie du trépidant quartier tokyoïte d'Akihabara. La séance finie, dans l'encadrement d'une machiya, la jeune femme chausse de larges lunettes noires, puis pianote frénétiquement sur son smartphone.
Les menus dans un anglais approximatif à la devanture des estaminets rénovés. Torii miniatures made in China comme sortis d'un jeu vidéo et peluches du renard inari derrière la vitre. C'est à qui proposera la meilleure tranche de l'impérial bœuf de Kobe. La viande rouge ! Une entorse récente – et significative –, à la washoku, la cuisine traditionnelle. Ici wa, harmonie, rejoint yo, tout ce qui représente le monde occidental. Avant de franchir le seuil, deux voiles, l'un rouge safran, l'autre jaune pâle, et le signe Kanpai, santé ! Autrement dit, dans une société millimétrée au suprême, les soirs de dévergondage : cul sec !
Des cadres, hommes et femmes, salary people, en costumes et jupes impeccables, se pliant sans réserve au consensus social de l'extrême retenue, parcourent toujours plus vite la ville vrombissante. Personne n'ose croiser son voisin du regard. Allons, cet attaché-case ne resserrerait-il pas un petit manga bien coquin ? De grands adolescents amateurs de collégiennes sagement dévergondées. Rarement cet homme ou cette femme. Jadis, confidence sur l'oreiller : bien des Japonaises, des Japonaises intelligentes, épousent des Occidentaux pour enfin s'affranchir des tâches ménagères et des gamineries en garçonnière.
Le monde de Sei Shônagon n'est plus. Depuis belle lurette. Qui, aujourd'hui, lit encore, ici, dans l'empire des mutations à tout crin, ses Notes de chevet ? Dans l'avion, j'avais emporté pour le relire Kyoto de Yasunari Kawabata. Depuis le tournant des années 1970, tout est allé vivement sur la voie de l'industrialisation outrancière. Les quelques vestiges hier agréables à l'œil, au toucher, à l'odorat ont disparu. Je suis nostalgique. Le Japonais ne l'est pas.
Portiques de bois, encens qui fume. À l'angle d'une ruelle près du canal, je tombe sur l'échoppe d'un antiquaire. Incongruité dans le décor et l'ambiance. Je feuillette les livres d'estampes. Voici quelques reproductions, bien tournées, de Hiroshige, les derniers beaux jours du monde flottant. Là, côtoyant des vues imprenables sur papier de riz, ce dessin : une grue à couronne rouge survolant les marais de Tsurui aux confins du Hokkaido. J'invoque la Sumida, le fantôme de Nagai Kafu, Edo, la solaire réfractaire. « Vous vous intéressez au Japon d'autrefois ? », me demande le patron aux doigts diaphanes.
D'un jet en taxi, je retrouve mes quinze pierres du jardin Ryoan-ji. Personne. Un petit miracle. Une heure dans le bruissement des feuilles. Soudain, jaillie de l'ombre, une voix murmure :
« Tourne-toi de ce côté.
Je suis seul moi aussi.
Crépuscule d'automne. »